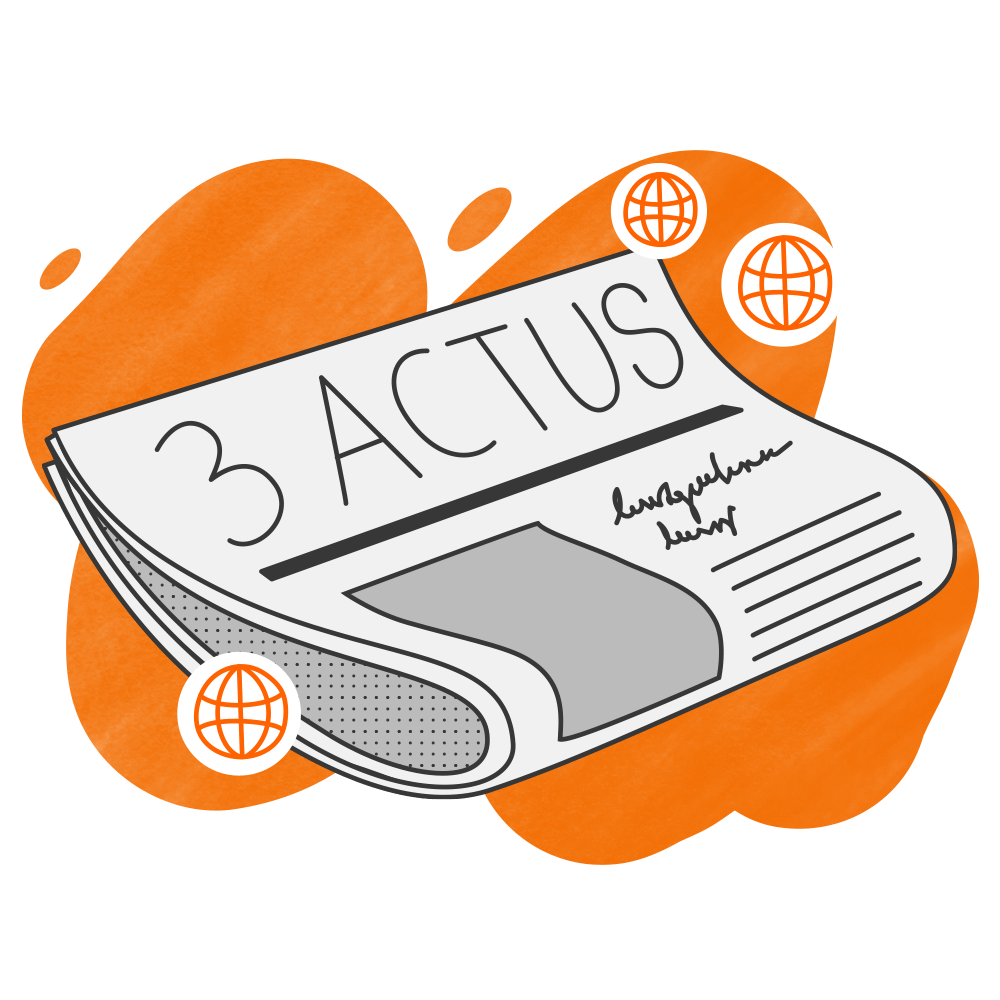La dette publique atteint 112,5 % du PIB
L’INSEE a publié les chiffres de la dette publique en France. Ainsi l’hexagone passe la barre symbolique des 3000 milliards d’euros au premier trimestre, portant sa dette publique à 112,5 % du PIB. En valeur absolue, l’endettement public atteint 3013,4 milliards d’euros, fin mars 2023, et s’alourdit de plus de 63 milliards d’euros à la fin de ce premier trimestre. Un héritage lourd en partie dû à l’accroissement des dépenses publiques liées à la crise sanitaire.
En dix ans, la situation française s’est donc largement dégradée, en comparaison de ses voisins européens, passant d’une dette qui représentait 90,6 % du PIB à la situation actuelle. Dix ans auparavant, la France figurait donc parmi les bons élèves, face à la moyenne de la zone euro qui atteignant 90,7 %.
Si l’écart est si important aujourd’hui, et semble se creuser davantage, ce serait en raison des difficultés de la France à rationaliser ses dépenses publiques, là où ses voisins européens semblent adopter une attitude bien plus stricte à cet égard. Le Président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, s’inquiète par ailleurs de cette réticence vis-à-vis de nos voisins. Et les récentes réformes, notamment sur le système des retraites, ne semblent pas constituer des objectifs suffisants pour recouvrer un endettement similaire à la moyenne de la zone euro. En 2026, la France pourrait donc être le seul pays européen à ne pas afficher un déficit inférieur à 3 % de son PIB.
Industrie française : des signes de reprise
L’industrie française semble reprendre des couleurs ! En tout cas pour les secteurs les moins énergivores. La production industrielle progresse de 1,2 % au mois de mai, une hausse plus soutenue dans le secteur manufacturier avec + 1,4 %. Une croissance portée par un retour à la normale de l’activité dans les raffineries et le secteur du raffinage notamment, en raison de la fin des mouvements sociaux. A noter toutefois que cette hausse semble plutôt pérenne.
Selon l’INSEE, cette reprise d’activité serait, sur les trois derniers mois, supérieure à celle des trois mois équivalents, un an plus tôt. Une progression portée par un secteur en particulier : les transports et l’automobile où l’activité progresse de + 17,3 %. La baisse de la pression sur les composants électroniques participerait à ce bon d’activité.
Un enthousiasme qui ne serait toutefois pas partagé par les plus gros consommateurs en énergie. En dehors de l’industrie des biens d’équipement qui fait un bond de plus de 8 %, la production des autres produits industriels diminue de 1,2 %, aux côtés des industries extractives, de l’énergie et de l’eau qui diminuent de 1,9 %. Ces industries souffrent toujours de la pression exercée par les prix de l’énergie qui pèsent sur leurs coûts de production en raison de contrats négociés sur un an, au moment où le cours de l’énergie était à son comble. Parmi les secteurs en difficulté, on retrouve notamment l’industrie papetière (-25 %) la sidérurgie (-20 %) et les produits chimiques (-13 %).
Énergie : pas de baisse avant 2027 selon Engie
Du côté des prix de l’énergie, si une accalmie semble se dessiner, les prévisions sont toutefois peu enthousiastes. D’après ENGIE, les cours du gaz et de l’électricité devraient rester plus élevés que leurs niveaux historiques en Europe au moins jusqu’en 2027. L’accalmie observée pourrait donc être de courte durée, et ce pour plusieurs raisons.
En premier lieu, si les stocks de gaz et de pétrole conjugués avec le déclin de la demande en énergie ont permis d’entretenir une baisse structurelle des prix, elle devrait se limiter à la fin de l’hiver 2023-2024. Les cours ne devraient ainsi pas poursuivre leur chute passée cette échéance et rester sur un plateau haut. D’après les estimations de l’organisme, le gaz s’échangera entre 50 et 60 euros le mégawattheure jusqu’en 2027. L’électricité quant à elle, ne devrait pas descendre en dessous de 100 euros le MWh, contre 40 à 50 euros à son niveau d’avant-crise en Ukraine.
Les tensions à venir s’expliquent notamment par un déséquilibre structurel du marché, soumis à une plus grande volatilité en raison de l’augmentation des coûts de transports, dorénavant par bateau sous forme de GNL, provenant du monde entier. Engie souligne d’ailleurs que l’Europe a doublé ses importations de GNL en 2022. Un mode de transport plus soumis à des évolutions donc, mais aussi plus exposé à la concurrence d’autres pays qui souhaitent s’approvisionner en énergie, sur des volumes limités pouvant rapidement renverser l’excès d’offre par rapport à la demande. Parmi les facteurs pouvant faire monter les prix du GNL, Engie redoute un hiver froid et rigoureux qui pourrait faire pression sur le stock mondial, parmi d’autres incertitudes comme la production de nouvelles capacités de production, aujourd’hui concentrées en Asie.
Enfin, le faible niveau de production d’électricité d’origine nucléaire devrait contribuer à maintenir les coûts de l’électricité à un niveau élevé entre 2023 et 2025, en France, selon Engie. De l’autre côté, la hausse des prix des combustibles, toujours utilisés pour produire de l’électricité en compensation des centrales nucléaires inopérantes, devrait maintenir cette pression. Le parc atomique devrait contribuer à la baisse des prix à partir de 2026, alors que le prix du droit à polluer sur le marché européen continue d’augmenter.
Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l’auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.
Sources :